 MUSIQUE >> La Martinique
MUSIQUE >> La Martinique 
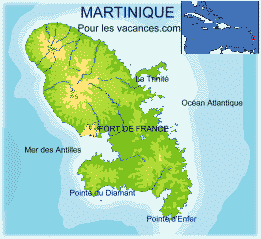
Introduction :
Pour comprendre la musique traditionnelle martiniquaise et donc la culture de la Martinique, il faut distinguer la musique rurale de la musique urbaine.
Après l'abolition de l'esclavage en 1848, la musique créole trouva son lieu de prédilection et de croissance à Saint-Pierre, capitale culturelle de la Martinique pendant le XIXème siècle jusqu'à la catastrophe qui la réduisit en cendres le 8 mai 1902. La ville de Saint-Pierre possédait depuis la fin du XVIIIème siècle un théâtre où se donnaient des concerts, se jouaient des opéras, et où l'on organisait plusieurs bals annuels.
La musique rurale de la Martinique est constituée de la musique « bèlè » (signifie "bel-air") issue de l’Afrique, du quadrille et de la haute-taille provenant de l’Europe. Jouée par des connaisseurs, elle est destinée à être dansée par des initiés.
NB : Le bèlè est à la fois un style de chanson, une danse, une musique
rythmée et un instrument à percussion, il est donc un genre à part entière.
Ces musiques se jouent à des moments précis : elles accompagnent la journée. Par exemple, aux temps anciens, les champs de cacao et de café étaient assez éloignés les uns des autres et s’étalaient sur de grandes étendues à flanc de montagne. On chantait le "gran son" en retournant son champ. Les coups de houe étaient rythmés par les kon’ lambi (conques de lambi) et le bouillonnement de la terre raconté par le tambour à timbre. Le grand son était chanté par deux solistes masculins ayant une large étendue de voix. On retournait la terre en allant vers le sommet de la montagne, après quoi, on la sillonnait en descendant la montagne et le mazon-n, chant pour une seule voix accompagnait cette phase du travail avec toujours deux kon’ lambi qui marquaient le coup de houe.

[Remonter]
Instruments traditionnels :
- Percussions :
- Le bèlè : Tambour qui accompagne la danse bèlè.
- Le ti bwa : Fait d'un morceau de bambou horizontal et qui se joue avec des baguettes de bois de goyaviers. Le ti-bwa est confectionné à partir de deux baguettes, branchettes d’arbres ligneux et durs (goyaviers, tibom, caféier) que l’on taille et fait sécher au soleil. Il est joué par un ti-bwatè (joueur de ti-bwa) sur la partie arrière du tambour bèlè et marque le rythme au son de « tak-pi-tak-pi-tak ».
- Ti baume
- Les chacha : Sorte de maracas.
- Kon’ lambi : Conques de lambi.
- Vents :
- Le kazoo
- La flûte de bambou
- + L'accordéon
- Cordes :

[Remonter]
Chants :
Les chants, outre leur fonction de rythmer le travail, permettaient de raconter l’histoire de l’île, de la communauté, du voisinage, de relater avec ironie les différends entre colons, les déboires d’un camarade ou d’un contremaître…
- Le bèlè (> bel-air) : À l’origine, ce sont des mélodies (air = chanson) chantées par les mulâtres et les esclaves affranchis (domestiques), ayant pour thème l’amour ou la nostalgie. Par la suite, les esclaves des plantations vont chanter des mélodies relatant leurs misères, leurs souffrances, leurs tristesses. Elles étaient accompagnées de tambours et de « ti bwa » et de « ti baume ». Le « bèlè » est accompagné par un rythme à 2 ou 4 temps.
- Bélia (> belle il y a) : Crée en 1848, il est considéré comme un chant d’encouragement à l’action, un chant de victoire, à 3 temps syncopés.

[Remonter]
Danses :
- Danses rurales, de campagnes :
- Le bèlè : Danse à 2 ou 4 temps... Le bèlè en lui-même est composé de plusieurs musiques :
- les bèlè de travail : fouyé tè, rédi-bwa, téraj kay, coupé kan-n, mazon-n et gran son
- les bèlè de divertissement : bèlè, gran bèlè, bélia, kalennda, danmyé et ladja
- les bèlè pour veillées mortuaires : bénézuel, kanigwé, karésé yo, ting bang
- les danses « la lin’ klè» : mabèlo, woulé, mango.
- Le grand bèlè (> grand bel-air) : Danse à 3 temps. Aux dires des « anciens » c’est cette composante qui confirme la qualité du danseur et du joueur de tambour parce que réputée être difficile.
- Le ting-bang : Danse qui serait issue du Congo exécutée par des garçons et filles formant un cercle et bougeant leurs bras d’avant en arrière. Rythme à 2 temps.
- La Kalennda : Danse vigoureuse symbolisant l’amour car il est question du déhanchement que la danseuse exécute pour narguer le cavalier. Rythme à 2 temps ayant un tempo presto.
- Le Kanigwé : Danse qui semble être une caricature de la haute-taille et du quadrille adaptée par les classes paysannes et ouvrières. Rythme à 2 temps.
- Le zouk : Danse apparue vers 1980
- Le danmyé : Après la journée, on dansait le ladja ou le danmyé. Le danmyé permet de se délasser après le labeur ; son rythme est rapide et enjoué. Il invite à danser. C’est aussi une forme douce de la danse interdite de ladja.
- Le ladja : Le ladja est une danse de combat accompagnée de tambour, ti-bwa et chant. Il fut interdit par l’Eglise catholique à cause de l’utilisation du tambour (les africains utilisaient le tambour pour communiquer avec leurs divinités). Plus lent que le danmyé, ce qui lui donne un caractère plus grave, il était pratiqué le samedi soir. Seuls les majo (majors en français) dansent le ladja qui s’achève parfois par la mort d’un des combattants. On appelle major un danseur qui fait autorité. Ses seules armes sont son corps, son agilité, son intelligence. Le ladja nécessite une préparation longue et rigoureuse des majors et fait appel à une maîtrise d’éléments paranormaux, surnaturels, que certains qualifient de quimbois, rite équivalent au vaudou haïtien.
- Danses de villes (plus raffinées) : Ces danses venues d’Europe, d’abord dansées en ville, elles ne survivront qu’à la campagne par la suite.
- Les quadrilles : Danses anciennes pour deux couples.
En Martinique, ces contredanses faisaient alterner les valses à
deux temps et les valses à trois temps. Ce sont des danses de plein
air.
- Les figures du quadrille standard :
- Pantalon : Le Roi Louis-Philippe en 1830 contrairement aux usages dansa en pantalon et non en culotte.
- L’Eté : Qui s’appelait autrefois « avant-deux » du fait que cavaliers et dames faisaient deux pas en avant suivis de deux pas en arrière.
- La Poule : À cause d’un chef d’orchestre nommé VINCENT qui imita le chant d’une poule.
- La Pastourelle : Qui est en fait une déclaration d’amour d’un berger à une bergère ou inversement.
- La Finale ou Galop : Qui venait « clôturer » la danse : danseurs et danseuses font de petits sauts.
- La haute-taille : C'est en fait la version « parlée » du quadrille en ce sens qu’elle nécessite la présence d’un commandeur - chanteur qui va énumérer les différentes figures sus-visées du quadrille. La Haute-taille n’existait qu’au Sud de l'île.
- La valse : Arrivée en Martinique vers 1730, la
valse a connu, comme à Cuba, des transformations et évolutions
qui en font un genre musical créole. Le tempo de la valse a été
ralenti, ce qui en a fait le support de textes parfois mélancoliques.
Au XIXème siècle, la valse "passillo" a été
ramenée de Panama. Elle n’a pas été modifiée
dans le fond par les musiciens martiniquais parce que correspondant déjà
à une forme d’expression créole, mais a été
interprétée avec les instruments dont nous disposions, à
savoir violon et piano.
Styles :
- Le bèlè : Danse à 2 ou 4 temps, parfois même à ...
- Chouval
Bwa : Musique qui accompagnait autrefois les manèges
de chevaux de bois en Martinique.
Groupes et chanteurs traditionnels célèbres : Kako Dou, Maurice JALLIER (1929-2019), ...

[Remonter]
Écoutes proposées :
|
Titre
|
Interprète
|
Écoute
|
Commentaire
|
Chouval Bwa
...
Tambour Bèlè
Chansons : Lazazou, Céfilon, Mirogréa, ... |
Maurice JALLIER |
|
... |
+ En savoir plus :
Pour nous écrire :  >> N'hésitez pas à nous proposer un site
consacré à la musique et aux danses traditionnelles de la Martinique,
ou des informations pédagogiques complémentaires concernant cette
île...
>> N'hésitez pas à nous proposer un site
consacré à la musique et aux danses traditionnelles de la Martinique,
ou des informations pédagogiques complémentaires concernant cette
île...

[Remonter]
[Autre région de
France]
Et maintenant, à vous de jouer !

© PLANTEVIN.
![]() MUSIQUE >> La Martinique
MUSIQUE >> La Martinique ![]()
![]() >> N'hésitez pas à nous proposer un site
consacré à la musique et aux danses traditionnelles de la Martinique,
ou des informations pédagogiques complémentaires concernant cette
île...
>> N'hésitez pas à nous proposer un site
consacré à la musique et aux danses traditionnelles de la Martinique,
ou des informations pédagogiques complémentaires concernant cette
île...